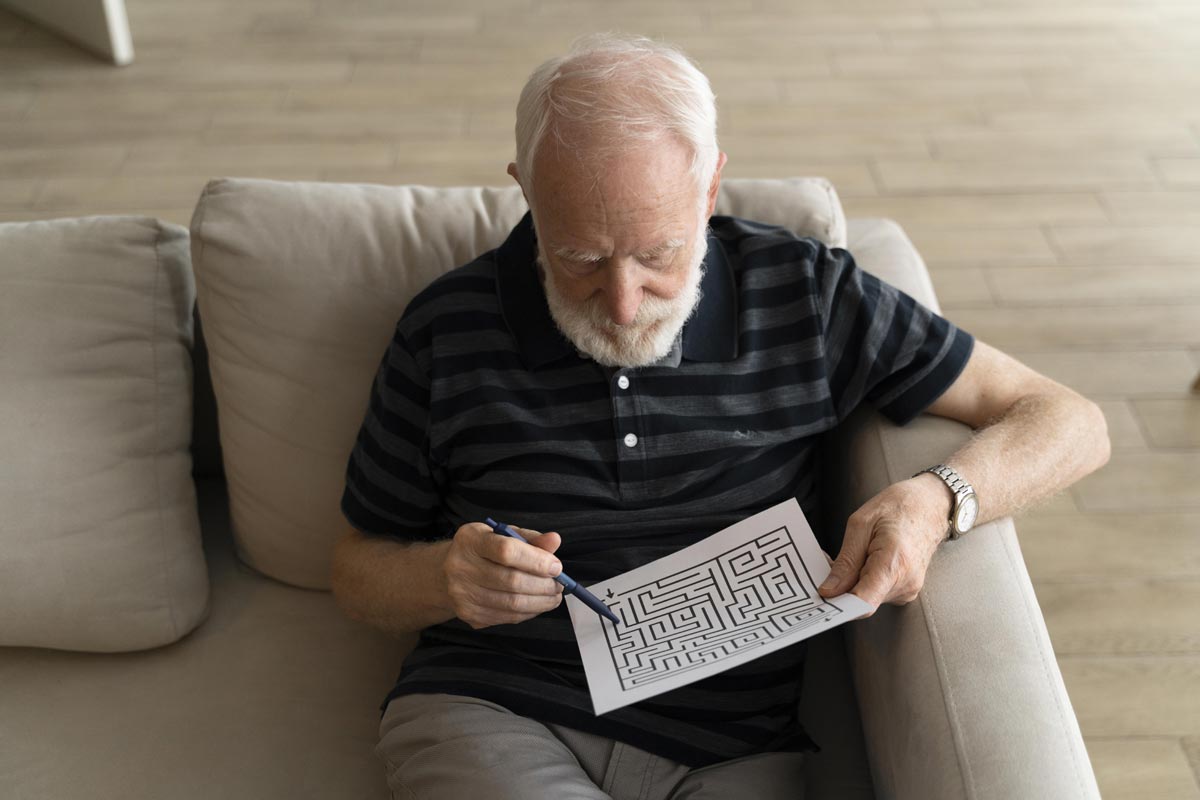Affection inflammatoire chronique du système nerveux central, la sclérose en plaques résulte d’une atteinte de la gaine de myéline entourant les fibres nerveuses. Elle entraîne des troubles neurologiques variables selon les zones touchées. Un point complet sur ses manifestations, les méthodes diagnostiques et les approches thérapeutiques.
Sommaire
Une maladie chronique du système nerveux central
La sclérose en plaques, abrégée SEP, est une maladie auto-immune qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central. Le corps, en dérèglement immunitaire, s’attaque à la gaine de myéline, une enveloppe protectrice entourant les fibres nerveuses. Cette dégradation ralentit ou bloque la transmission des influx nerveux.
Elle affecte principalement les adultes jeunes, entre 20 et 40 ans, avec une prédominance chez les femmes. Sa progression est imprévisible, et les symptômes peuvent varier d’une personne à l’autre. Certaines personnes peuvent connaître des années de stabilité alors que d’autres sont confrontées à une aggravation rapide.
Les causes précises restent incertaines, mais des facteurs génétiques et environnementaux semblent impliqués. Des infections virales antérieures, une carence en vitamine D, ou encore le tabagisme ont été associés à une augmentation du risque de développer la maladie.
Symptômes fréquents et variés
Les premiers signes apparaissent souvent de façon soudaine. Ils peuvent inclure des troubles moteurs, sensitifs, visuels ou encore cognitifs. La maladie se manifeste par poussées ou de manière progressive.
Les symptômes les plus souvent rencontrés sont :
- Fatigue persistante et intense
- Engourdissements ou picotements dans les membres
- Problèmes de coordination et d’équilibre
- Spasticité ou raideurs musculaires
- Troubles de la vue, notamment vision double ou floue
- Difficultés à marcher ou faiblesse musculaire
- Troubles urinaires ou intestinaux
- Troubles cognitifs (attention, mémoire, concentration)
Ces symptômes peuvent durer quelques jours ou plusieurs semaines, puis régresser partiellement ou totalement. Leur intensité peut aussi varier selon les périodes, ce qui complique le quotidien des personnes concernées. Certains malades doivent adapter leur emploi du temps, ou réorganiser leur environnement personnel et professionnel afin de mieux gérer les périodes difficiles.
Dans certains cas, la maladie se manifeste par une perte de la vision d’un seul œil (névrite optique), ou par des sensations anormales comme des fourmillements, des brûlures ou une impression de serrement autour du torse. Des troubles de l’humeur peuvent également apparaître, souvent liés à l’impact psychologique du diagnostic et aux difficultés du quotidien.
Diagnostic : un processus délicat
Le diagnostic repose sur une combinaison d’examens cliniques et paracliniques. Il est souvent long, car les symptômes peuvent ressembler à ceux d’autres maladies neurologiques. Un bilan neurologique approfondi est la première étape, mené par un spécialiste.
Les outils les plus couramment utilisés sont :
| Examen | Utilité |
|---|---|
| IRM cérébrale et médullaire | Visualisation des plaques de démyélinisation |
| Potentiels évoqués | Mesure du temps de réaction des voies nerveuses |
| Analyse du liquide céphalorachidien | Présence d’anomalies immunitaires |
Pour confirmer le diagnostic, les lésions doivent être disséminées dans le temps et dans l’espace, c’est-à-dire apparaître à différents moments et dans plusieurs zones du système nerveux central. Cette phase peut s’étendre sur plusieurs mois, voire années. Une annonce précoce permet toutefois une prise en charge rapide, limitant les risques de dégradation neurologique.
Parfois, un second avis est nécessaire, en particulier lorsque les signes sont atypiques ou les résultats ambigus. Les neurologues référents disposent souvent d’une expertise plus poussée pour affiner le diagnostic.
Différentes formes de la maladie
La sclérose en plaques ne suit pas toujours le même schéma d’évolution. On distingue plusieurs formes cliniques, chacune ayant ses caractéristiques propres.
- Forme rémittente-récurrente : la plus courante. Elle alterne entre poussées et phases de rémission.
- Forme progressive primaire : l’état s’aggrave lentement dès le début, sans réelles rémissions.
- Forme secondairement progressive : elle fait suite à une forme rémittente, puis l’évolution devient continue.
Chaque forme nécessite une stratégie médicale adaptée, ce qui souligne l’importance d’un suivi personnalisé. Certains malades peuvent répondre favorablement à des traitements qui n’ont que peu d’effet chez d’autres. Une approche sur mesure reste donc essentielle.
Il existe également des formes peu actives, parfois qualifiées de « bénignes » lorsqu’elles provoquent peu de handicaps même après plusieurs années. Cependant, cette appellation est controversée, car la maladie peut évoluer de façon imprévisible.
À lire également
Prise en charge et traitements disponibles
Bien que la sclérose en plaques ne puisse pas être guérie à ce jour, des traitements existent pour atténuer les symptômes, réduire la fréquence des poussées et ralentir l’évolution de la maladie.
On distingue plusieurs types d’approches :
- Traitements de fond : ils modulent le système immunitaire pour limiter l’inflammation. Exemples : interférons, acétate de glatiramère, traitements oraux (fingolimod, diméthylfumarate), anticorps monoclonaux (ocrelizumab, natalizumab).
- Traitements des poussées : les corticoïdes à forte dose sont souvent prescrits pour accélérer la récupération.
- Traitements symptomatiques : ils ciblent les troubles précis (spasticité, douleur, troubles urinaires, etc.).
La rééducation, les soins paramédicaux et un accompagnement psychologique sont également recommandés pour améliorer le quotidien des patients. Dans certains cas, des professionnels comme les ergothérapeutes ou les orthophonistes peuvent intervenir afin d’aider à retrouver ou maintenir certaines fonctions.
Des recherches sont en cours pour mettre au point de nouvelles méthodes de prise en charge, y compris dans le domaine de la neuroprotection et de la réparation de la myéline. Certaines pistes, comme les cellules souches, sont encore au stade expérimental mais suscitent un intérêt croissant dans le monde médical.
Une surveillance et un suivi au long cours
Le suivi médical repose sur des consultations régulières avec un neurologue. L’objectif est d’adapter les traitements en fonction de l’évolution de la maladie et des réactions individuelles. Des examens d’imagerie répétés permettent d’évaluer l’activité des lésions.
La sclérose en plaques implique souvent une modification du mode de vie, avec une attention portée à l’activité physique, au repos, à l’alimentation et à la gestion du stress.
Les proches et les structures d’accompagnement jouent un rôle clé dans le maintien d’une certaine autonomie. Les associations de patients proposent informations, groupes de parole, conseils pratiques et soutien moral.
L’accès aux soins reste inégal selon les territoires, mais les professionnels de santé s’efforcent de garantir une prise en charge coordonnée. Certains centres hospitaliers sont spécialisés dans les maladies neurologiques et offrent un suivi complet.
Un accompagnement pluridisciplinaire peut être mis en place, associant neurologue, médecin rééducateur, infirmier, psychologue, assistant social et autres intervenants. Ce travail en équipe vise à couvrir l’ensemble des besoins du patient, du diagnostic jusqu’à l’évolution sur le long terme.